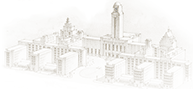Le travail autonome au Canada et au Québec : une étude sur les facteurs contribuant à son évolution
Student work [Graduate studies]
Author(s)
Advisor(s)
Abstract(s)
Ce travail dirigé s’est intéressé à l’étude des facteurs qui concourent à l’évolution du travail autonome au Canada et au Québec. La question suivante a été posée : « Quels sont les facteurs ayant déterminé l’évolution du travail autonome entre 1981 et 2020, au Canada et au Québec, en regard à la littérature scientifique? » Afin d’y répondre, notre modèle de recherche a reposé sur une variable dépendante : le « travail autonome ». Neuf (9) variables indépendantes ont été sélectionnées. Celles-ci comprennent le taux de syndicalisation, le salaire minimum, le taux de diplomation universitaire (baccalauréat et supérieur), les investissements en recherche et développement, le taux d’immigration par rapport à la population, le taux de chômage, le taux d’activité des femmes, la part des jeunes de 15-24 ans et la part des 55-64 ans dans la population. Notre modèle se base sur l’utilisation de variables dichotomiques pour les provinces et les années. Les résultats de notre étude tendent à confirmer l’effet en U sur la propension à devenir travailleur autonome en fonction de l’âge. Les gens dans les groupes d’âge des 15-24 ans et des 55-64 ans semblent plus résilients aux risques liés à l’entrée dans l’entrepreneuriat. L’immigration est corrélée négativement au travail autonome, contredisant d’autres études affirmant l’inverse. Le taux de syndicalisation est corrélé négativement également, confirmant la théorie de la segmentation d’Atkinson. À l’inverse, le niveau de scolarité est corrélé positivement, confirmant la théorie du capital humain. Le taux de chômage est négativement corrélé à cette forme de travail atypique, laissant entendre que les effets « pull » dominent sur les effets « push ». Les investissements en R&D sont corrélés positivement à cette forme de travail alors que le taux d’activité des femmes conduit à l’effet inverse. Dans le premier cas, l’innovation technologique stimule l’entrepreneuriat. Dans le deuxième cas, le groupe étudié a une plus grande aversion au risque.
Note(s)
Travail dirigé présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maîtrise en relations industrielles (M.Sc.)This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.