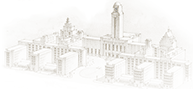L’homoparentalité au masculin : entre différence et distinction
Thesis or Dissertation
Abstract(s)
Sous la rationalisation du plaisir et l’impulsion d’une forme renouvelée de nationalisme sexuel (Béjin et Pollack, 1977 ; Jaunait, Le Renard et Marteu, 2013), une nouvelle catégorie a fait son apparition sur la scène publique depuis une quinzaine d’années, celle de l’homoparentalité. Animés par un désir de reconnaissance sociale qui oscille entre être comme tout le monde tout en étant reconnu dans leur(s) identité(s), les pères mettent en place des stratégies discursives qui allient différenciation et indifférenciation afin de se distinguer dans l’institution familiale.
Retracer l’histoire de leur processus de parentalisation qui croise, sans jamais s’y confondre, celle des parents, permet de mettre en évidence ce qu’il y a de commun à la parentalité et aux personnes, étant toutes reliées par un système de représentations symboliques, de normes, mais aussi par le principe de la distinction des sexes. Dans les discours, c’est bien au nom d’être un homme que les pères s’ingénient à montrer au quotidien qu’ils ne sont pas des mères, tout en (re)donnant chacun à leur manière, et selon leur position, un sens distinct à cette identité relationnelle. Ainsi donnent-ils à voir, semblablement à tous les parents, des places éducatives spécialisées selon des pôles relationnels qui se distinguent, tout en puisant leurs références à partir des figures symboliques Père-Mère héritées de la psychanalyse. Par leurs pratiques éducatives, entre intégration sociale et valeur d’autodétermination, ils font un travail de transmission des normes et stéréotypes de genre et participent ainsi à édifier la différence des sexes.
Ce mémoire, sur fond socio-anthropologique et qui s’inspire des travaux d’Irène Théry, permet de réhabiliter le concept de personne et met en évidence ce qui relie les identités distinctes entre elles, et ce au-delà de la tentation à l’essentialisation et à la substantialisation. Ultimement, il invite à revisiter l’évidence selon laquelle l’identique n’est que réplique. Under the impulse of the rationalization of pleasure and the rise of a renewed form a sexual nationalism (Béjin et Pollack, 1977; Jaunait, Le Renard et Marteu, 2013), same-sex parenting has made its apparition and gained attention in the public domain over the past 15 years. Moved by their desire for social recognition, which oscillates between being like everybody else and being acknowledged for their distinct identities, gay fathers use multiples discursive strategies, combining differentiation and in differentiation, to distinguish themselves in the institution of family.
Tracing the history of their parenthood which crosses, without ever being confused with, that of the parents themselves, it is possible to highlight common aspects connecting parenthood and people going through it: symbolic representation systems, norms, but also the principle of distinction of the sexes. In their speeches, it is in the name of being men that gay fathers strive to show on a daily basis that they are not mothers, while giving, each in their own way and according to their position, a distinct meaning to this relational identity. Thus they demonstrate, similarly to all parents, specialized educational places according to relational poles, while drawing their references from the symbolic father-mother figures. Through their educational practices, between social integration and self-determination, they do a job of transmitting gender norms and stereotypes, and thus participate to pass on the difference between sexes.
This thesis, based on a socio-anthropological background and greatly inspired by the work of Irène Théry, allows us to rehabilitate the concept of “person”, highlights what connects distinct identities together, and this beyond the temptation to essentialize and substantialize. Ultimately, it invites to revisit the evidence that the identical is only replica.
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.